Avis de beau temps sur la lagune vénitienne
Entre créateurs aptes à imposer leur vision du monde et illustrateurs au talent plus que louable, cette 70e Mostra est un grand cru. Trois titres nous ont particulièrement marqués.
 Dans cette 70e Mostra, plusieurs titres ont pour nous de très loin mené en tête une course plus divisée que jamais entre poids lourds et chevau-légers, entre créateurs aptes à imposer leur vision du monde et illustrateurs dont on peut à l’occasion louer le talent. Parmi les premiers il convient d’en isoler un, seul parvenu à explorer avec succès la voie de l’imaginaire contre celle de la réalité, l’onirisme à la Fellini et à l’occasion à la Kubrick dont il témoigne, relevant d’une extrapolation futuriste qui rejette moins la prise en compte de notre société que la négation de cette dernière. Il s’agit de Terry Gilliam qui, dans The Zero Theorem, s’interroge une fois de plus sur le sens de la vie, avec une acuité philosophique grotesque proche de celle qu’il avait portée à son apogée il y a trente ans dans Brazil. L’auteur lui-même insiste sur le fait que seule la mise à jour du regard et l’évolution de la société justifient d’avoir réinvesti ce classique. On retrouve dans ce budget modeste, même si chaque image est une source d’invention et de créativité qui met en valeur un Christoph Waltz méconnaissable, les figures symboliques de la jeune femme blonde qui suscite le désir (Mélanie Thierry), qu’elle soit réelle ou issue du monde virtuel des clics sur le clavier, et celui de l’ordonnateur de l’ordinateur (Matt Damon).
Dans cette 70e Mostra, plusieurs titres ont pour nous de très loin mené en tête une course plus divisée que jamais entre poids lourds et chevau-légers, entre créateurs aptes à imposer leur vision du monde et illustrateurs dont on peut à l’occasion louer le talent. Parmi les premiers il convient d’en isoler un, seul parvenu à explorer avec succès la voie de l’imaginaire contre celle de la réalité, l’onirisme à la Fellini et à l’occasion à la Kubrick dont il témoigne, relevant d’une extrapolation futuriste qui rejette moins la prise en compte de notre société que la négation de cette dernière. Il s’agit de Terry Gilliam qui, dans The Zero Theorem, s’interroge une fois de plus sur le sens de la vie, avec une acuité philosophique grotesque proche de celle qu’il avait portée à son apogée il y a trente ans dans Brazil. L’auteur lui-même insiste sur le fait que seule la mise à jour du regard et l’évolution de la société justifient d’avoir réinvesti ce classique. On retrouve dans ce budget modeste, même si chaque image est une source d’invention et de créativité qui met en valeur un Christoph Waltz méconnaissable, les figures symboliques de la jeune femme blonde qui suscite le désir (Mélanie Thierry), qu’elle soit réelle ou issue du monde virtuel des clics sur le clavier, et celui de l’ordonnateur de l’ordinateur (Matt Damon).
À l’opposé stylistique de The Zero Theorem, le film qui nous a le plus impressionné est l’Autre Heimat, chronique d’une vision, d’Edgar Reitz bien sûr (hors compétition). On croyait que Reitz en avait fini avec sa chronique du village de Schabbach développée en 1984 sur 929 minutes, travail prolongé en 1992 sur 25 heures et 32 minutes, puis en 2004 sur 10 heures et 58 minutes, mais nous étions à terme. L’histoire aux 140 personnages principaux et 5 000 figurants de ce petit village du Hunsrück, en Rhénanie, qui commençait au lendemain de la Première Guerre mondiale, nous avait conduits en 1982 et il n’y avait plus rien à raconter. Patatras ! Avec ce nouveau titre, Edgar Reitz nous fait le clou du « prequel », qui consiste à raconter ce qui s’est passé avant là où le « sequel », la suite donc, raconte ce qui s’est passé ensuite. Pendant quatre heures de projection, nous voici à nouveau sur les mêmes lieux, cette fois au milieu du XIXe siècle dans une Allemagne ravagée par la pauvreté et le despotisme alors que l’espoir des habitants repose pour  nombre d’entre eux sur l’émigration en Amérique du Sud, celle de deux frères étant au centre de l’intrigue. Le noir et blanc est somptueux et l’intrigue passionnante. On reste sans fin saisi par le talent du cinéaste… comme nous l’étions depuis des dizaines d’heures de projection et plusieurs décennies de conception.
nombre d’entre eux sur l’émigration en Amérique du Sud, celle de deux frères étant au centre de l’intrigue. Le noir et blanc est somptueux et l’intrigue passionnante. On reste sans fin saisi par le talent du cinéaste… comme nous l’étions depuis des dizaines d’heures de projection et plusieurs décennies de conception.
Parlons aussi de cette réussite qu’incarne Stephen Frears avec Philomena. Judi Dench, dont le rôle sent le prix d’interprétation, y incarne cette femme qui « fauta » jeune fille et se vit retirer son enfant par des religieuses irlandaises en 1952. Elle ne cessa de tenter de le retrouver. Touchant, juste et totalement réussi.
Jean Roy
Les Prix de l’UJC 2013
 L’UJC a décidé pour la huitième fois d’attribuer pour la huitième fois ses prix annuels destinés à mettre en valeur les métiers du journalisme cinématographique:
L’UJC a décidé pour la huitième fois d’attribuer pour la huitième fois ses prix annuels destinés à mettre en valeur les métiers du journalisme cinématographique:
• le Prix de l’UJC 2013, pour l’ensemble de son œuvre, à Pascal Mérigeau
• le Prix de l’UJC de la jeune critique 2013 à Noémie Luciani
• le Prix de l’UJC de la meilleure biographie ou du meilleur entretien 2013 concernant une personnalité du cinéma, à Eric Libiot et Christophe Carrière pour leur entretien avec Michael Haneke dans « L’Express » du 24 octobre 2012 (l’entretien est toujours accessible gratuitement en ligne à http://www.lexpress.fr/culture/cinema/michael-haneke-il-faut-saisir-le-spectateur-pas-l-etouffer_1178656.html )
• La Plume d’Or 20131 du meilleur journaliste de cinéma de la Presse étrangère en France, enfin, a été décernée pour la huitième fois conjointement par l’UJC et l’Association de la Presse Etrangère à Lisa Nesselsson, pour sa couverture pluri décennale du cinéma français dans la presse anglo-saxonne.
L’Europe de l’Est à l’honneur au 63° festival de Berlin
 La 63ème édition de la Berlinale aura confirmé que le Festival de Berlin est durablement implanté dans le paysage des « grands festivals » cinématographiques, et, surtout, constitue le premier grand rendez-vous international de l’année des professionnels. Il reste, en même temps, un festival populaire, puisqu’il est ouvert au public, qui l’a plébiscité en 2013 avec un chiffre annoncé de plus de 250.000 spectateurs. Les films venant d’Europe de l’Est y ont cette année remporté de nombreux prix.
La 63ème édition de la Berlinale aura confirmé que le Festival de Berlin est durablement implanté dans le paysage des « grands festivals » cinématographiques, et, surtout, constitue le premier grand rendez-vous international de l’année des professionnels. Il reste, en même temps, un festival populaire, puisqu’il est ouvert au public, qui l’a plébiscité en 2013 avec un chiffre annoncé de plus de 250.000 spectateurs. Les films venant d’Europe de l’Est y ont cette année remporté de nombreux prix.
A tout seigneur, tout honneur, parmi les films présentés en compétition officielle, le jury présidé par Wong Kar-Waï a en effet décerné la récompense suprême, l’Ours d’Or, au roumain, « Poziţia Copilului » (« Child’s Pose »), de Călin Peter Netzer (ci-contre avec sa productrice). Il a ainsi rejoint pour une fois le Prix de la Critique Internationale (Fipresci), ce qui n’est pas si courant! Consacré à la dénonciation de la corruption, le film montre avec une grande sobriété de style les efforts désespérés d’une femme d’un milieu favorisé pour sauver de la prison son fils, auteur d’un accident mortel, quitte à corrompre policiers, témoins, et même parents de l’enfant tué. L’autre grand vainqueur du palmarès, est encore en provenance de l’Europe de l’Est. Il s’agit de Danis Tanović, le scénariste et réalisateur bosniaque qui avait reçu, entre autres, l’Oscar du meilleur long métrage étranger pour son premier film, « No man’s land », également prix du meilleur scénario  à Cannes en 2001. Son film, « Un épisode dans la vie d’un ramasseur de fer », a remporté deux Ours d’Argent: le Grand Prix du Jury, et, pour l’acteur Nazif Mujić, le prix de la meilleure interprétation masculine – Paulina Garcia recevant le prix de la meilleure interprétation féminine pour le chilo-espagnol « Gloria », de Sebastian Lelio. Le cinéaste iranien Jafar Panahi, toujours empêché de sortir de son pays et sous le coup d’une condamnation à ne plus exercer son métier, a reçu quant à lui un prix du meilleur scénario pour « Pardé », co-réalisé avec Kamboziya Partovi.Quant aux Français, ils sont revenus bredouilles, si l’on met à part l’Ours d’Or spécial pour sa carrière remis à Claude Lanzmann, le réalisateur de « Shoah », à qui le festival a consacré une rétrospective.
à Cannes en 2001. Son film, « Un épisode dans la vie d’un ramasseur de fer », a remporté deux Ours d’Argent: le Grand Prix du Jury, et, pour l’acteur Nazif Mujić, le prix de la meilleure interprétation masculine – Paulina Garcia recevant le prix de la meilleure interprétation féminine pour le chilo-espagnol « Gloria », de Sebastian Lelio. Le cinéaste iranien Jafar Panahi, toujours empêché de sortir de son pays et sous le coup d’une condamnation à ne plus exercer son métier, a reçu quant à lui un prix du meilleur scénario pour « Pardé », co-réalisé avec Kamboziya Partovi.Quant aux Français, ils sont revenus bredouilles, si l’on met à part l’Ours d’Or spécial pour sa carrière remis à Claude Lanzmann, le réalisateur de « Shoah », à qui le festival a consacré une rétrospective.
Le Festival de Berlin ne se limite en effet pas à la compétition officielle et aux ors du tapis rouge orchestrés par Dieter Kosslick, son Directeur. Cette année, la sélection officielle alourdie par quelques films convenus, de l’avis général, méritait ainsi parfois d’être oubliée au profit par exemple de la section « Panorama », dirigée par Wieland Speck, qui est l’équivalent d’un « Certain Regard » à Cannes. Méritait ainsi très largement le détour des films forts, comme « Exposed », présenté dans l’intéressante section « Documentaire » du « Panorama », oeuvre audacieuse qui marque un retour de la cinéaste Beth B.. De même, fut apprécié dans une section dite « Berlinale Special », « The look of Love », l’excellent docu-fiction consacré par Michael Winterbottom à Paul Raymond, l’ancien magnat britannique des magazines et spectacles « risqués » des années 60 à 80. Ajoutons y les perspectives ouvertes par le « Forum International du Jeune Cinéma » dirigé par Christoph Terhechte, quipeut être comparé aux sections « parallèles » cannoises. On y remarqua notamment « Krugovi », du cinéaste serbe Srdan Golubovi, une introspection sur les guerres civiles qui ont déchiré l’ancienne Yougoslavie, un film qui reçut le Prix de la Critique Internationale (Fipresci) pour la section du Forum – encore l’Europe de l’Est! Moins courues par les professionnels, par manque de temps, les sections « Géneration 14 », « Cinéma culinaire », où un repas suit les  projections, et la rétrospective, furent en revanche fort suivies par le public berlinois, qui peut en outre bénéficier maintenant d’une décentralisation du festival à travers toute la ville. Nous avons pu constater que les cinémas de l’ancienne partie orientale de la ville étaient aussi remplis que les salles principales de la « Potsdamer Platz ».
projections, et la rétrospective, furent en revanche fort suivies par le public berlinois, qui peut en outre bénéficier maintenant d’une décentralisation du festival à travers toute la ville. Nous avons pu constater que les cinémas de l’ancienne partie orientale de la ville étaient aussi remplis que les salles principales de la « Potsdamer Platz ».
Quant aux professionnels du cinéma du monde entier, acheteurs et vendeurs, ils répondirent largement à l’appel du Marché du Film berlinois, qui est incontestablement devenu leur premier grand rendez-vous de l’année, sous la houlette assurée de Beki Probst, sa directrice. Les professionnels américains s’y rendent en particulier à nouveau de plus en plus nombreux, obligeant le Marché à ouvrir de nouveaux lieux d’accueil, en sus du bâtiment principal du Marché, le « Martin Gropius Bau ». Le grand stand Unifrance y fut fort achalandé, et pour la seconde année, les « indépendants » américains, y ont donc repris des espaces. On rappellera enfin la poursuite de la populaire opération « Talent Campus », destinées aux futurs jeunes talents des métiers du cinéma, et la seconde année d’ouverture de la « résidence », berlinoise, sorte de « Villa Médicis » allemande pour futurs cinéastes.
De nombreux autres événements se déroulent traditionnellement en marge du Festival. On citera ainsi la très officielle opération « Shooting Stars », destinée à faire connaître de jeunes acteurs européens prometteurs, organisée par « European Film Promotion », qui regroupe les organisme de promotion du cinéma européens à l’étranger, ou la remise des « Teddy awards », les prix faisant honneur à la tradition libertarienne de la ville de Berlin.
Philippe J. Maarek
Pour la défense des droits des Journalistes et Critiques de Cinéma sur Internet
Communiqué de Presse du 4 février 2013
Devant la diversification des supports de presse, l’Union des Journalistes de Cinéma rappelle solennellement qu’Internet n’est pas une zone de non droit.
En particulier, la critique de cinéma et les articles journalistiques sur le cinéma sont écrits par des auteurs dont il faut de facto respecter les droits, et leur reprise sur Internet ne peut pas être automatique sans respect des droits d’auteur, aussi bien dans leurs aspects financiers que moraux.
De même, la cession et le rachat de plus en plus fréquents de sociétés de presse, même après un dépôt de bilan, n’exemptent pas du respect des journalistes titulaires des droits d’auteur
Festival de Kiev: « Molodist 42 »
 Une jeunesse européenne chahutée par le bouleversement des valeurs traditionnelles, autant affectives qu’économiques et c’est, à travers les films en compétition, tout un nouveau monde qui se construit sous nos yeux.
Une jeunesse européenne chahutée par le bouleversement des valeurs traditionnelles, autant affectives qu’économiques et c’est, à travers les films en compétition, tout un nouveau monde qui se construit sous nos yeux.
Du 20 au 28 octobre 2012, le festival international du film de Kiev, le Molodist 42, s’est déroulé dans plusieurs cinémas de la capitale ukrainienne. Les deux principales compétitions, celle des courts-métrages et celles des longs métrages ont donné un bel instantané de la grande Europe, du Portugal aux confins de la Russie. Ces compétitions sont ouvertes aux jeunes réalisateurs qui présentent leur premier film.
La compétition des cours-métrages a été d’une excellente qualité, que ce soit dans l’utilisation des images d’archives, comme pour Le Facteur humain du français Thibault le Texier, sur la rationalisation du travail des salariés ; dans la dénonciation de la crise financière, avec Circus de l’espagnol Pablo Remon ou dans l’importance de la poésie pour une génération contemplative, comme dans le film géorgien, Shavi Tuta de Gabriel Razmadze.
Parmi eux, deux films d’animation, Sommeil de la polonaise Marta Pajek et Oh Willy… une réalisation franco-belge d’Emma De Swaef et Marc James Roels. Depuis un an, ce petit bijou tourne dans de nombreux festivals et rafle tous les prix. Des figurines de tissu, dont la douceur et la fragilité s’accordent particulièrement bien avec cette histoire de deuil et de résilience. Un chef d’œuvre qui donne tout son sens à l’animation.
La compétition des longs métrages a montré combien les citoyens européens sont aujourd’hui mobiles : Eastaglia de Darya Onyyshcheriko en est le meilleur exemple. Une coproduction entre l’Ukraine, l’Allemagne et la Serbie et des personnages de différents pays, immigrés heureux dans leur pays d’accueil, expatriés professionnels, histoires d’amour entre langues dfférentes, des destins imbriqués et des rêves communs, les jeunes montrent une réelle volonté de dépasser les clivages culturels.
Lors de la remise des prix, le président du jury officiel, l’artiste hongrois Zoltan Kamondi, réalisateur, dramaturge et producteur, a prononcé un brillant hommage à Antonin Arthaud. Rappelant l’importance du cri et de la révolte hors des sentiers battus pour le poète français, il a remis le prix du meilleur long-métrage au réalisateur grec Babis Makridis pour son film « L ». Tragédie burlesque où un homme, au volant de sa voiture, cherche une route à suivre, balloté entre ses désirs de jeunesse, de voyage et de maturité et affrontant la figure de l’ours. Cet animal a inspiré toutes les cultures européennes depuis des siècles, il est signe de puissance, d’effroi et de force, entre mythe et folklore. Dans ce film grec, il est le miroir d’un homme à la recherche d’une nouvelle expression de la virilité. Et le cri de l’acteur principal est l’un des plus long de l’histoire du cinéma !
Le jury Fipresci a attribué son prix au film franco/israélien Le Jardin d’Hanna d’Hadar Friedlich qui sortira dans quelques semaines en France sous le nom de Beautiful Valley. Ce qui laisse une nouvelle fois songeur face à l’absurdité des titres de film lors de la distribution en salle… Le jury œcuménique a récompensé Hemel de Sacha Polack. Portrait d’une jeune femme cherchant la frontière entre sexe et amour, et de son père, incapable d’assumer son statut. Présenté en février dernier à la Berlinale, ce film néerlandais avait déjà obtenu un prix Fipresci.
Magali Van Reeth
Le Festival de Toronto fait l’événement
Il n’y a dorénavant plus aucun doute, le Festival International de Toronto est devenu l’événement cinématographique majeur de la seconde partie de l’année, se démarquant maintenant considérablement de ses principaux concurrents de l’automne, et notamment de Venise, par l’importance de la participation des professionnels du cinéma du monde entier, mais aussi par la ferveur de son public de spectateurs cinéphiles. Depuis deux ans, Toronto bénéficie en outre d’une remarquable base, le Bell Lightbox un bâtiment tout neuf, construit grâce à des millions de dollars de donations. Il dispose ainsi tout au long de l’année d’espaces d’exposition, de cinq salles de cinéma, et de bureaux permanents sur ses six étages. Cela fait maintenant du groupe un acteur permanent de la vie culturelle de la capitale économique du Canada.
Le Festival se prolonge ainsi toute l’année pour les habitants de la ville, avec par exemple une reprise cet automne de l’exposition sur le monde de James Bond qui a fait cet été le plein au musée Barbican de Londres. Mais il est aussi devenu un événement cinématographique majeur grâce à deux facteurs qu’il est sans aucun doute le seul à avoir su réunir aussi bien, sous la houlette de Piers Handling, qui préside avec brio de longue date à la destinée de l’ensemble de ses activités, assisté maintenant de Cameron Bailey à la direction artistique du Festival à proprement parler.
 Le premier facteur de réussite est son côté non compétitif, qui lui permet d’attirer nombre de productions indépendantes, nord-américaines en particulier, qui n’auraient jamais pris le risque d’une compétition avec les aléas des jurys et de leurs compositions hétéroclites. Deux avantages en découlent ainsi, d’abord, la possibilité de présenter des films pas forcément complètement inédits, des « simples » premières nord-américains de films européens ou autres remarqués dans d’autres festivals par ses sélectionneurs par exemple. Le deuxième avantage est de donner ainsi une rampe de lancement à des films indépendants nord-américains qui y trouvent public, presse et professionnels. Ainsi, depuis nombre d’années, Toronto est-il devenu une rampe de lancement des Oscars. Cette année encore, parmi d’autres, Argo, le film de Ben Affleck inspiré par l’histoire authentique de la demi douzaine de diplomates américains qui ont réussi à échapper à la prise d’otage du personnel de l’ambassade du pays à Téhéran, du temps de Jimmy Carter, a ainsi pris ses marques de façon très nette à Toronto pour la compétition, comme The Artist l’avait fait l’an dernier, d’ailleurs. Il faut dire que Ben Affleck, qui s’est donné le rôle principal du film, tient le spectateur en haleine : sa mise en scène est nerveuse et précise, d’une grande efficacité, n’hésitant pas à utiliser tous les ressorts possibles pour cela (jusqu’à une boite de vitesse récalcitrante au tout dernier moment, qui semble empêcher pendant quelques seconde le départ du bus des fugitifs vers l’avion salvateur…). Un film qui s’est en outre révélé d’actualité, puisqu’au moment de sa projection, on manifestait, et hélas tuait, devant et dans plusieurs ambassades américaines au Moyen-Orient. Argo a d’ailleurs failli remporter le prix « Blackberry » du Public, arrivant très près du vainqueur, Silver Linings Playbook, de David O. Russell, un film aidé par la présence de Robert de Niro et de Bradley Cooper, surnommé depuis quelques temps outre-Atlantique le « nouveau Clooney ».
Le premier facteur de réussite est son côté non compétitif, qui lui permet d’attirer nombre de productions indépendantes, nord-américaines en particulier, qui n’auraient jamais pris le risque d’une compétition avec les aléas des jurys et de leurs compositions hétéroclites. Deux avantages en découlent ainsi, d’abord, la possibilité de présenter des films pas forcément complètement inédits, des « simples » premières nord-américains de films européens ou autres remarqués dans d’autres festivals par ses sélectionneurs par exemple. Le deuxième avantage est de donner ainsi une rampe de lancement à des films indépendants nord-américains qui y trouvent public, presse et professionnels. Ainsi, depuis nombre d’années, Toronto est-il devenu une rampe de lancement des Oscars. Cette année encore, parmi d’autres, Argo, le film de Ben Affleck inspiré par l’histoire authentique de la demi douzaine de diplomates américains qui ont réussi à échapper à la prise d’otage du personnel de l’ambassade du pays à Téhéran, du temps de Jimmy Carter, a ainsi pris ses marques de façon très nette à Toronto pour la compétition, comme The Artist l’avait fait l’an dernier, d’ailleurs. Il faut dire que Ben Affleck, qui s’est donné le rôle principal du film, tient le spectateur en haleine : sa mise en scène est nerveuse et précise, d’une grande efficacité, n’hésitant pas à utiliser tous les ressorts possibles pour cela (jusqu’à une boite de vitesse récalcitrante au tout dernier moment, qui semble empêcher pendant quelques seconde le départ du bus des fugitifs vers l’avion salvateur…). Un film qui s’est en outre révélé d’actualité, puisqu’au moment de sa projection, on manifestait, et hélas tuait, devant et dans plusieurs ambassades américaines au Moyen-Orient. Argo a d’ailleurs failli remporter le prix « Blackberry » du Public, arrivant très près du vainqueur, Silver Linings Playbook, de David O. Russell, un film aidé par la présence de Robert de Niro et de Bradley Cooper, surnommé depuis quelques temps outre-Atlantique le « nouveau Clooney ».
Le deuxième facteur de succès de Toronto réside justement dans cette présence d’un véritable public payant, un peu comme à Berlin – et contrairement à Cannes, où le public majoritairement formé de professionnels est ainsi moins représentatif de la réalité et sans aucun doute plus exigeant qu’un public « normal». Grâce à l’ouverture du Bell Lightbox et à l’utilisation de nombre de salles d’un énorme complexe cinématographique voisin, le Festival se dédouble en effet, une partie des salles n’accueillant que le public payant (avec quelques invités professionnels quand ils le demandent), et l’autre n’accueillant que les professionnels, sans les contraintes des précédentes (pas de queues, un accès rapide aux films). Du coup, les projections prennent l’aspect de « sneak-previews » grandeur nature et permettent ainsi de tester les films, et notamment ceux des productions « indépendantes » américaines ou les importations potentielles d’outremer aux yeux des professionnels présents. Ainsi, en 2012, si Passion de Brian de Palma, a été aussi mal accueilli à Toronto qu’il l’avait été à Venise, malgré la superbe prestation de Rachel Mc Adams, des œuvres comme le Spring Breakers de Harmony Korine, The Sessions, de Ben Lewin, ou The Paperboy de Lee Daniels – certains vus à Cannes et encore dans les cartons – ont montré par leur succès public aux 4280 professionnels en provenance de 80 pays présents qu’ils pouvaient envisager une sortie nord-américaine ou étrangère sereine malgré des aspects un peu difficiles ou provocateurs.
 Cette année, le festival se divisa en une bagatelle de quinze sections différentes, présentant ainsi un éventail considérable. On pouvait certes y voir des films à grand public dans la section « Galas », où quasiment toutes les stars hollywoodiennes, de Tom Hanks à Will Smith, Robert Redford ou Helen Hunter, ou d’outremer, comme Monica Belucci ou Pierce Brosnan, passèrent un jour ou un autre. Mais, à l’autre extrême, il y avait les séances de minuit des films d’horreur ou de série B de la section « Midnight Madness » programmée par Colin Geddes, aux 1500 places remplies à craquer malgré l’heure tardive tous les soirs de spectateurs enthousiastes – et sympathiquement bruyants !
Cette année, le festival se divisa en une bagatelle de quinze sections différentes, présentant ainsi un éventail considérable. On pouvait certes y voir des films à grand public dans la section « Galas », où quasiment toutes les stars hollywoodiennes, de Tom Hanks à Will Smith, Robert Redford ou Helen Hunter, ou d’outremer, comme Monica Belucci ou Pierce Brosnan, passèrent un jour ou un autre. Mais, à l’autre extrême, il y avait les séances de minuit des films d’horreur ou de série B de la section « Midnight Madness » programmée par Colin Geddes, aux 1500 places remplies à craquer malgré l’heure tardive tous les soirs de spectateurs enthousiastes – et sympathiquement bruyants !
Quant au cinéma français, il eut la part belle à Toronto, avec pas moins de 24 films dans les différentes sections du festival, placés sous l’ombrelle d’Unifrance, dont la réception fut l’une des plus suivies des professionnels. Parmi eux, Dans la maison, de François Ozon, s’octroya le Prix Fipresci de la Critique Internationale de la section « Présentations spéciales » – le prix de la section « Discovery » allant à Call Girl, de l’Américain Mikael Marcimain.
Couronnement indispensable, enfin, pour les visiteurs comme pour les cinéastes « locaux », le festival est aussi une plate-forme de lancement inégalable pour les films canadiens, les seuls d’ailleurs à être placés sous la coupe d’un « vrai » jury, qui récompensa cette année de son prix « Sky Vodka » Antiviral, où Brandon Cronenberg prend la suite de son père David, avec une première œuvre dans le registre de la science-fiction, ex-aequo avec Blackbird, de Jason Buxton.
Philippe J. Maarek
Quand Dieu s’invite à la Mostra de Venise
 Il flottait comme un léger air de mélancolie sur la 69ème Mostra de Venise. Pourtant, comme le projet d’un nouveau palais de festival a été apparemment enterré faute de moyens, le grand chantier qui défigurait le Lungomare a partiellement disparu laissant la place à une jolie promenade où il faisait bon se reposer entre les projections. Mais les alentours du festival paraissaient étrangement vides, attirant visiblement beaucoup moins de monde que les années précédentes. Créée il y a maintenant 80 ans, la Mostra qui marque cette année le retour d’Alberta Barbera comme directeur (il avait dirigé le festival de 1999 à 2002 avant d’être « débarqué » par le gouvernement Berlusconi), a certainement besoin d’un nouveau souffle si elle ne veut pas s’endormir sur sa lagune hors du temps. Mais la situation est difficile dans un pays plongé dans une crise dont il ne sortira pas sitôt et le marché du film, annoncé par Barbera comme une des nouveautés pour booster le festival est encore loin de tenir ses promesses. Enfin le spectre du puissant festival de Rome, qui se prépare sous l’égide de son prédécesseur plein de ressources, Marco Muller, semblait planer comme un ombre menaçante sur le Lido.
Il flottait comme un léger air de mélancolie sur la 69ème Mostra de Venise. Pourtant, comme le projet d’un nouveau palais de festival a été apparemment enterré faute de moyens, le grand chantier qui défigurait le Lungomare a partiellement disparu laissant la place à une jolie promenade où il faisait bon se reposer entre les projections. Mais les alentours du festival paraissaient étrangement vides, attirant visiblement beaucoup moins de monde que les années précédentes. Créée il y a maintenant 80 ans, la Mostra qui marque cette année le retour d’Alberta Barbera comme directeur (il avait dirigé le festival de 1999 à 2002 avant d’être « débarqué » par le gouvernement Berlusconi), a certainement besoin d’un nouveau souffle si elle ne veut pas s’endormir sur sa lagune hors du temps. Mais la situation est difficile dans un pays plongé dans une crise dont il ne sortira pas sitôt et le marché du film, annoncé par Barbera comme une des nouveautés pour booster le festival est encore loin de tenir ses promesses. Enfin le spectre du puissant festival de Rome, qui se prépare sous l’égide de son prédécesseur plein de ressources, Marco Muller, semblait planer comme un ombre menaçante sur le Lido.
Est-ce l’air du temps ou la crise avec ses incertitudes et ses angoisses existentielles qui suscitent cette recherche de promesses de salut religieux et idéologiques et qui semblent gagner insidieusement non seulement notre société mais transforme également certains cinéastes en passeurs de messages spirituels plus ou moins douteux? Curieusement, cette année, le grand thème de la Mostra était la foi, (ou son absence!), servie à toutes les sauces religieuses et idéologiques, surtout dans les 18 films de la compétition internationale dont la plupart privilégiaient le contenu à la forme.
Au film d’ouverture The Reluctant Fundamentalist de Mira Naïr qui plaide pour une certaine compréhension envers la radicalisation islamiste des intellectuels séduit par l’Ouest mais finalement dégoûtés par le capitalisme (américain) exacerbé, répondait en écho d’un des pays théocratiques par excellence, l’Arabie saoudite, le premier film fort surprenant et courageux d’une autre femme, Wadja, d’Haifaa al Mansour, témoignant de l’enfermement forcé dans une réclusion totale des femmes.
Dans le glacial Paradis : Glaube ,deuxième partie de sa trilogie, le metteur en scène autrichien Ulrich Seidl invite le spectateur à accompagner son actrice fétiche Maria Hofstätter sur son chemin de croix de l’évangélisation auprès de populations viennoises vivant en marge de la société. Elle passe tout son temps libre en faisant du porte-à-porte avec une madone en bois sous le bras quand elle ne se flagelle pas jusqu’au sang agenouillée devant le crucifix de sa chambre, et un soir elle prend même le crucifix dans son lit. Promptement alertée par cette scène de masturbation pour le moins insolite, une organisation ultra-conservateur catholique avait immédiatement porté plainte pour blasphème contre Seidl, l’actrice, les producteurs et même le directeur du festival.
Le film de Marco Bellocchio Bella Addormentata nous replonge lui dans les polémiques qui avaient divisé l’Italie en 2009 autour de la mort d’Eluana Englaro dont l’assistance respiratoire avait été débranchée à la demande de son père et des médecins après 17 ans de coma. Les catholiques « intégristes » se sont rendus devant le palais du festival en brandissant des pancartes avec la photo d’Elena et de la Vierge et ont réclamé le retrait immédiat du film. Pourtant, ce film, un peu trop didactique et qui malheureusement noie son sujet dans des méandres sentimentaux d’ajouts fictionnels n’a rien d’un pamphlet provocateur mais s’efforce plutôt d’explorer la question de l’euthanasie sous tous ses angles.
L’un des films les plus attendus de la compétition, To the wonder, de Terence Malick, a laissé les spectateurs et même les fans de ses premières œuvres perplexes. Lors d’un voyage en France, Neil (Affleck, séduisant comme un morceau de bois sec), rencontre Marina (Kurylenko) et, après des déclarations d’amours en voix off alignant des platitudes affligeantes sur fond de la très photogénique Baie de Saint Michel, la ramène avec sa petite fille dans un « bled » perdu des plaines de l’ Oklahoma. Comme il fallait s’attendre, la vie quotidienne dans ce lotissement dépourvu de toute charme éteint assez rapidement l’amour passionnel qu’éprouve l’héroïne pour son amant monosyllabique et réticent à l’épouser. Marina plie bagage pour revenir quelques temps plus tard sans que l’on comprenne pourquoi, et ainsi de suite. Cerise sur le gâteau de cette rêverie pseudo -chrétienne exaspérante et frôlant souvent le ridicule c’est le personnage d’un prêtre (Javier Bardem) en proie à une sévère crise de foi qui erre sans arrêt à travers sa maison et les quartiers pauvres de sa banlieue pendant que l’on entend sa voix en off commentant ses doutes comme un bruit de fond jusqu’au jour où se produit le miracle ; il retrouve Jésus, qui, cette fois-ci, revient même en force vers lui. « Le Christ en moi, le Christ au dessus de moi, Le Christ en dessous de moi, Le Christ à ma droite, le Christ à ma gauche » jubile-t-il tandis que les palissades en bois qui entourent les maisons du lotissement s’éclairent lentement, illuminés par les rayons dorés du soleil levant.
Mais la compétition avait encore d’autres surprises divines dans son programme – notamment avec Lemale Et Ha’Chalal (Fill the Void) de Rama Burshtein (Israël), d’ailleurs le seul film en compétition réalisé par une femme. Sans distance critique aucune mais avec une maîtrise tout à fait louable, la réalisatrice met en scène la vie d’une communauté ultra-orthodoxe à Tel Aviv où une jeune fille est amenée par sa famille à accepter d’épouser le mari de sa soeur décédée afin que l’enfant du couple reste auprès de sa grand-mère. Bursthein, strictement vêtu selon les codes vestimentaires des haredi ultra-orthodoxes, livre dans le dossier de presse sa confession de foi et énonce les objectifs de son film « fidèle à la façon dont je vois le monde« sans la moindre ambiguité . Que la réalisatrice puisse présenter en Israël ses films uniquement aux femmes de sa communauté d’où les hommes sont exclus des projections -soit. En revanche, on peut se poser la question de savoir si la compétition de la Mostra de Venise devait servir de plateforme pour faire l’éloge d’un monde où la femme n’est pas égale de l’homme, Reste aussi le mystère d’une intervention divine par laquelle le jury a cru bon d’honorer ce film en décernant le prix de la meilleur actrice à sa jeune protagoniste.
Heureusement, The Master de Paul Thomas Anderson nous livre une antidote aux rêveries fondamentalistes véhiculées dans certains films de cette compétition. Avec bravoure et une force créatrice d »image et narrative qui sort ce film du lot, Anderson présente, sans la nommer explicitement , la vie d’un fondateur de secte au début des années 50 (dans laquelle on pourrait reconnaître Ron Hubbard , père de l’Eglise scientologique). Ce Dodd (merveilleusement incarné par Philip Seymour Hofmann) auteur charismatique et despotique, séducteur et manipulateur, porté sur les boissons fortes s’est inventé une nouvelle forme de croyance fondée sur un mélange de philosophies, de religions et de thérapies plus ou moins obscures comme le voyage dans le temps, qui rassemble autour de lui de plus en plus d’adeptes. Mais l’idée géniale d’Anderson est de non pas de raconter cette histoire en forme de biopic mais à travers un autre personnage fictionnel, celui du vétéran de guerre ultra violent , Freddy, (Joaquin Phoenix en sparring partner cogénial) profondément traumatisé par la guerre au Pacifique. Entre ces deux personnages aux caractères forts et diamétralement opposés s’établit une relation ambigüe de maitre-élève voire même de père-fils. Mais Dodd, face à l’impossibilité de maîtriser la violence de Freddie, lui redonne en quelque sorte sa liberté. Sans prendre position, Anderson nous amène au centre du monde clos d’une secte en démontrant les mécanismes de la soumission, tout en laissant une petite porte ouverte par laquelle Freddie réussira peut-être un jour à s’échapper.
Dans un tout autre registre , Kim Ki-Duk plonge ses fans avec Pieta une fois de plus dans la descente aux enfers d’une histoire de crime, châtiment et rédemption – parcours cher au christianisme, mais ici avec une radicalité et une cruauté visuelle qui dépasse par moments la limite de l’insupportable.
Mais c’est finalement The Fifth Season, film d’une force et d’une beauté visuelles absolument saisissantes du couple Jessica Woodworth et Peter Brosens, qui nous mène impitoyablement vers une apocalypse païenne qui, ici, se prépare lentement sur les terres lourdes d’un village au fin fond des Ardennes. Ce film complètement à part qui raconte une histoire d’évolution humaine à reculons où la bêtise, la cruauté et la méchanceté des hommes sont punies par une nature de plus en plus déchainée au fur à mesure que la violence entre les habitants dégénère n’est pas sans évoquer certains tableaux de Breughel.
Heureusement Olivier Assayas nous ramène vers la vie avec l’un des plus beaux films de la Mostra : Après Mai, un hommage aux années 70 à travers les aventures politiques de jeunes lycéens d’une banlieue de Paris. Ce film d’une intelligence, d’une luminosité et d’une tendresse salutaire dans l’évocation un brin nostalgique mais sans aucune fausse sentimentalité d’une époque qui aujourd’hui paraît plus lointaine qu’elle ne l’est réellement, est joué par huit jeunes acteurs et actrices de moins de vingt ans qui se glissent admirablement dans la peau de ces jeunes qui rêvaient de révolution, roulaient en bus Volkswagen, s’aimaient et se séparaient sur fond de discussions politiques incessantes, animés par des questionnements sur la façon de rendre le monde meilleur.
Barbara Lorey de Lacharrière
Prix Fipresci :
The Master de Paul Thomas Anderson (USA)
Orizzonti et Settimana Internazionale della Critica
L’intervallo de Leonardo Di Costanzo(Italie)
Au jury « Fipresci » de la Critique Internationale de Cannes 2012
Un festival de Cannes maussade arrosé par la pluie. La veille de l’ouverture, je longe le bord de mer et la croisette : yachts, hôtels et vitrines de luxe. Trop chers pour moi ! Le lendemain, le festival fonctionne comme une usine : rythme infernal de projections qui s’enchaînent et des affaires qui s’y traitent.
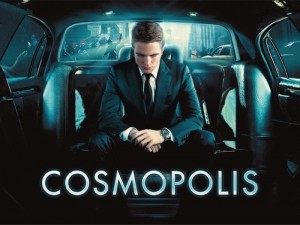 Membre du jury Un certain regard pour la Fédération internationale de la Presse de Cinéma, j’ai pu voir vu tous les films de cette sélection ainsi que ceux de Cannes Classic et de la Compétition officielle dont Cosmopolis de Cronenberg, métaphore sur le capitalisme en crise, et le superbe Holy Motors de Léos Carax, film de haute densité poétique et pour lequel mon cœur a battu très fort, espérant qu’il remporte un prix : espoir trompé par un palmarès décevant et peu audacieux.
Membre du jury Un certain regard pour la Fédération internationale de la Presse de Cinéma, j’ai pu voir vu tous les films de cette sélection ainsi que ceux de Cannes Classic et de la Compétition officielle dont Cosmopolis de Cronenberg, métaphore sur le capitalisme en crise, et le superbe Holy Motors de Léos Carax, film de haute densité poétique et pour lequel mon cœur a battu très fort, espérant qu’il remporte un prix : espoir trompé par un palmarès décevant et peu audacieux.
Diversité, sans toujours la qualité.
Un certain Regard provoque l’espoir de découvrir des films du monde entier, de styles et de genres différents, audacieux par leur regard, mais certains films cette année n’auraient pas dû y figurer. Ainsi, le film indien de la sélection, Miss Lovely d’Ashim Ahluwalia, autant rabatteur et complaisant que les films commerciaux qu’il prétend dénoncer, Blanco Elefante de Pablo Trapero et Antiviral de Brando Cronenberg. Le premier, misérabiliste, ne se distingue guère d’un mauvais téléfilm et Antiviral, prétendant dénoncer la « société du spectacle », n’est qu’un mauvais film de vampire, prétentieux, laborieux et qui s’éternise. D’ailleurs, la longueur des films était le défaut majeur de la sélection.
Dans Djeca d’Aida Begic, du passé de Rahima et de son jeune frère Nedim, le public doit deviner ce qui est advenu pour ces enfants de Sarajevo. Ici, le récit invite à suivre le présent de (Rahima), une jeune femme musulmane qui travaille dans la cuisine d’un restaurant et qui tente de protéger son jeune frère de la maffia, car Nedim est impliqué dans des trafics. L’actrice Marija Pikic joue le rôle d’une manière efficace et subtile. Le film montre le courage de Rahima affrontant des politiciens corrompus ou des criminels et décrit une société violente dont le quotidien renvoie au souvenir de la guerre à Sarajevo. Le film offre une bande sonore riche, un style visuel très nerveux et sa caméra, portée à l’épaule, accompagne les mouvements du personnage dans un rythme donnant de l’intensité.
Étudiant, le nouveau film du kazakh Omirbayev, s’inspire de Crime et Châtiment de Dostoïevski. Son tempo, ses images, sa direction d’acteur dans un jeu économe, sobre et “minimaliste” se placent sous l’influence de Bresson. Par de nombreux détails, Student construit une relation assez riche entre l’état du monde, l’évolution du personnage principal et le développement de son action. Sa structure globale et sa vision sont très cohérentes.
Laurence Anyways de Xavier Dolan est un film inégal, mais où il faut saluer le beau travail des deux acteurs principaux. Melvil Poupaud y est très subtil et s’impose dans une composition risquée de personnage d’homme voulant vivre dans l’identité d’une femme et Suzanne Clément, comédienne au jeu très puissant, impressionne. On sent, dans ce film, le désir sincère de faire du cinéma et Xavier Dolan, dans cette soif, expérimente différents styles. Certains moments forts prennent vie, mais l’écriture baroque de Laurence Anyways n’évite pas le maniérisme dans un film beaucoup trop long et sa musique redondante agace vite.
Dans Después de Lucia de Michel Franco, le personnage de Lucia est persécutée avec cruauté par ses « camarades » de classe pour avoir couché avec l’un d’entre eux. Le film prouve la vitalité du cinéma mexicain par un sujet fort, un jeu très juste de ses jeunes comédiens, mais le scénario manque de liens et sa fin est artificielle.
Gimme the loot d’Adam Leon possède de l’esprit, de la grâce et une bonne dose de vivacité. Cette comédie, genre rare dans la sélection de cette année, nous donne enfin à respirer et le plaisir de parcourir le Bronx avec son couple heureux de jeunes graffeurs toniques. Gimme the loot est un premier long métrage et il faut lui souhaiter du succès.
Dans le film collectif, 7 jours à La Havane, tourné par un réalisateur différent pour chaque jour, nous avons vu l’autre excellente comédie de la sélection, Diary of a beginner d’Elia Souleiman. Ce film succulent et burlesque, où il s’agit pourtant de la Palestine et de Cuba, provoque le rire. Avec le Rituel de Gaspard Noé, ce sont les deux meilleurs films de 7 jours à La Havane.
Notre jury a récompensé Beasts of the southern wild de Benh Zeitlin également lauréat de la Caméra d’or. Ce film émouvant montre l’aventure d’une petite fille, Huhspuppy, âgée de six ans dans son initiation à la vie. Hushpuppy, jouée par l’excellente Wallis Quvenzhané, vit parmi les plus pauvres, les exclus du bayou en Louisiane. Sa conscience des réalités et de ses responsabilités naîtra de la traversée de nombreuses épreuves. Récit d’initiation, ce premier long métrage surprend par la cohérence de sa vision, la qualité de sa mise en scène et sa profondeur. Mêlant le réalisme à la poésie, ce film réalisé par Benh Zeitlin est assez remarquable.
Laura Laufer
San Sebastian se réveille!
 Pour sa 59ème édition, le festival de San Sebastian s’est soudain réveillé : meilleure programmation, des séances quasi complètes et un palmarès qui décoiffe ! Si ces derniers temps la sélection ronronnait en terre basque, cette année la qualité était au programme et le public a répondu présent avec un bel enthousiasme. Pratiquement toutes les séances, de presse, de gala, au Vélodrome avec le public ou au Kursaal avec les invités, étaient complètes. Dans la sélection officielle, un beau mélange de réalisateurs confirmés et de jeunes talents, de films espagnols et asiatiques, de genres, du polar à la comédie.
Pour sa 59ème édition, le festival de San Sebastian s’est soudain réveillé : meilleure programmation, des séances quasi complètes et un palmarès qui décoiffe ! Si ces derniers temps la sélection ronronnait en terre basque, cette année la qualité était au programme et le public a répondu présent avec un bel enthousiasme. Pratiquement toutes les séances, de presse, de gala, au Vélodrome avec le public ou au Kursaal avec les invités, étaient complètes. Dans la sélection officielle, un beau mélange de réalisateurs confirmés et de jeunes talents, de films espagnols et asiatiques, de genres, du polar à la comédie.
Parmi les bonnes surprises, le nouveau film de Sarah Poley, Take this Waltz, un marivaudage très contemporain où le corps est complètement refoulé (ou en dépôt à la cuisine), laissant les sentiments et les trahisons se faire et se défaire en pensée… A l’opposé, la Madame Bovary d’Arturo Ripstein est plus charnelle, toujours dépressive et tout aussi mauvaise mère (elle nourrit sa fille chez Macdo) : Le Cœur a ses raisons, un huis-clos oppressant, serré, avec une remarquable mise en scène. Déception en revanche avec Amen de Kim Ki-duk qui filme ses souvenirs de vacances en Europe et nous les livres un peu bâclés.
Autre surprise, le rire est venu avec deux films français. Le Skylab où les vacances très franchouillardes de Julie Delpy ont emporté toutes les salles mais comme le disait un critique argentin hilare en sortant de la projection de presse, « les années 70, c’était les années 70 partout » ! Intouchables d’Eric Toledano et Olivier Nakache était présenté en clôture et a su autant émouvoir que faire rire, avec la rencontre d’un handicapé très riche et d’un grand mec cool un peu racaille, un moment de bonheur dans la grande salle du Kursaal.
Enfin dernière surprise, et de taille, un palmarès ébouriffant. La « Concha d’or » a été attribuée à Los Pasos dobles d’Isaki Lacuesta (Espagne/Suisse), un film qui n’avait même pas retenu l’attention des amateurs de pronostics. Le jeune réalisateur espagnol laisse ses personnages partir à la recherche des traces d’un peintre au pays Dogon. Rarement la notion très particulière du sacré, du mystère et du rôle très particulier de la nature et des ancêtres dans les sociétés africaines, n’a été aussi bien mise en images. On comprend pourtant que ce soit déroutant pour le grand public. Pratiquement tous les autres prix décernés par le jury présidé par l’actrice Frances Mc Dormes, ont été aussi déroutant pour le public.
Pour le prix du public, jusqu’au bout, la bataille a été serrée entre Et maintenant on va où ? de Nadine Labaki et Une Séparation d’Asgar Faradhi mais le dernier jour, c’est The Artist de Michel Hazanivicius qui a fait le raz de marée dans le cœur des spectateurs, avec un taux de satisfaction quasi unanime. Du côté des prix parallèle, pas de grande surprise en revanche. La Fipresci a récompensé le très « fiprescien » Sangue de meu sangue, du réalisateur portugais Jaõa Canijo ; les associations LTGB, Albert Knobs de Rodrigo Garcias, où Glenn Close interprète une femme parfaitement dissimulée sous un habit de maître d’hôtel dans un établissement très chic de l’Irlande du 19ème siècle. Enfin, le jury Signis a choisi le nouveau film de Hirokazu Kore-Eda justement intitulé Miracle.
Magali Van Reeth
Le Festival de Toronto toutes voiles dehors !
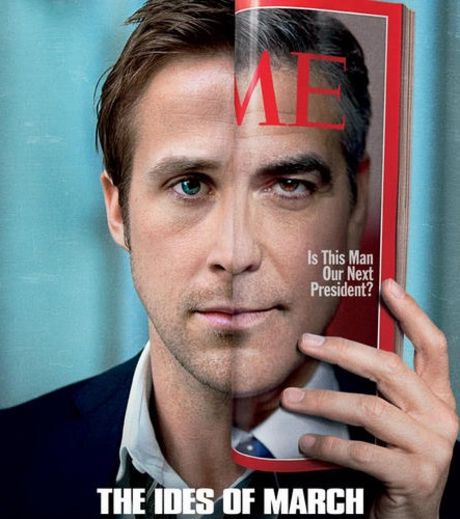 On savait déjà depuis quelques années que le Festival de Toronto était devenu l’une des trois ou quatre manifestations cinématographiques les plus importantes au monde, aussi bien du point de vue des films présentés que de celui de la profession, en particulier des exportateurs et acheteurs de films. Cette année, le Festival a bénéficié de la mise en service complète du Bell Lightbox, un immeuble entier flambant neuf comportant cinq salles de cinéma et des espaces d’exposition et de réunion, qui lui appartient en propre, après une souscription privée considérable. La manifestation s’est en outre maintenant regroupée dans la vicinité de son nouveau quartier général, sur quelques pâtés de maison de la ville, devenant ainsi infiniment plus facile pour les festivaliers. L’ouverture aux projections spéciales de la grande salle voisine de 1.500 places du théâtre « Princess of Wales » voisin a également donnée de nouvelles possibilités cette année.
On savait déjà depuis quelques années que le Festival de Toronto était devenu l’une des trois ou quatre manifestations cinématographiques les plus importantes au monde, aussi bien du point de vue des films présentés que de celui de la profession, en particulier des exportateurs et acheteurs de films. Cette année, le Festival a bénéficié de la mise en service complète du Bell Lightbox, un immeuble entier flambant neuf comportant cinq salles de cinéma et des espaces d’exposition et de réunion, qui lui appartient en propre, après une souscription privée considérable. La manifestation s’est en outre maintenant regroupée dans la vicinité de son nouveau quartier général, sur quelques pâtés de maison de la ville, devenant ainsi infiniment plus facile pour les festivaliers. L’ouverture aux projections spéciales de la grande salle voisine de 1.500 places du théâtre « Princess of Wales » voisin a également donnée de nouvelles possibilités cette année.
Mais l’édification d’une domicile permanent propre au Festival, avec de nombreuses autres manifestations dorénavant organisées tout au long de l’année, n’est pas la seule ambition de Piers Handling, qui dirige de longue date l’ensemble de ces opérations. Assisté par Cameron Bailey à la codirection du Festival du Film à proprement parler, Piers Handling est une fois de plus parvenu à présenter au début de l’automne la fine fleur du cinéma mondial, qu’il s’agisse des films d’auteur ou des « locomotives » hollywoodiennes – ce qui en fait un événement de plus en plus « glamour » qui a maintenant aussi l’honneur des pages des magazines « people »: Georges Clooney, « Bragelina », Madonna ou Juliette Binoche, les flashes des photographes ont crépité!
L’aspect non compétitif du festival lui a en outre permis, comme chaque fois, de présenter aussi bien des films inédits, que des films « phare » présentés durant les mois précédents dans le monde entier, à commencer par les films les plus forts du Festival de Venise (avec un léger décalage symbolique seulement). Qu’il s’agisse du Lion d’or, le Faust, film de la maturité d’Aleksander Sokurov, de Shame, dont la mise en scène remarquable de Steve Mc Queen a valu à son acteur principal, Michael Fassbender, la Coupe Volpi du meilleur acteur, ou du populaire film d’ouverture, Les Ides de mars, de George Clooney, Venise était à Toronto, en somme. Mais l’on y vit aussi plusieurs des grandes nouveautés anglo-saxonnes de l’automne, y comp ris parfois des œuvres de facture plus « grand public », comme l’intelligent et humoristique Hysteria, de la réalisatrice Tanya Wexler, avec notamment Maggie Gillenhaal, le désopilant The Oranges, de Julian Farino, avec une distribution menée par Oliver Platt, Leighton Meester, Allison Janney et Hugh Laurie, ou le Trespass de Joel Schumacher avec Nicole Kidman, lui, huis clos bien banal, en vérité, comparé à ceux de Michael Hanneke… On vit aussi à Toronto Damsels in distress, le grand retour à l’écran après une longue absence, de Whit Stilman, l’auteur de Barcelona, un film dont l’humour complice se lit à chaque instant à plusieurs degrés tant il est en réalité fait de subtiles complexités superposées.
ris parfois des œuvres de facture plus « grand public », comme l’intelligent et humoristique Hysteria, de la réalisatrice Tanya Wexler, avec notamment Maggie Gillenhaal, le désopilant The Oranges, de Julian Farino, avec une distribution menée par Oliver Platt, Leighton Meester, Allison Janney et Hugh Laurie, ou le Trespass de Joel Schumacher avec Nicole Kidman, lui, huis clos bien banal, en vérité, comparé à ceux de Michael Hanneke… On vit aussi à Toronto Damsels in distress, le grand retour à l’écran après une longue absence, de Whit Stilman, l’auteur de Barcelona, un film dont l’humour complice se lit à chaque instant à plusieurs degrés tant il est en réalité fait de subtiles complexités superposées.
Au total, le Festival, ce fut 336 films, en provenance de 65 pays (dont 268 longs métrages) projetés dans une vingtaine de sections, de la populaire « Midnight Movies » dédiée aux films qu’on aurait autrefois qualifiés « de Série B », à la plus allusive section de documentaires « Real to reel ». Parmi eux, les films français furent nombreux, plus d’une trentaine, menés notamment par The Lady, le film de Luc Besson inspiré par la vie de la dissidente birmane Aung San Suu Kyi, et par Mon pire cauchemar, en première mondiale, le nouvel opus d’Anne Fontaine dont Isabelle Huppert tient la vedette en compagnie de Benoit Poelvoorde.
Les habitants de Toronto se pressèrent nombreux dans les salles durant les onze jours du festival, comme à l’accoutumée, et récompensèrent du « Grand Prix Cadillac du Public« , Where do we go now?, le second film de la réalisatrice de Caramel, Nadine Labaki. Les critiques de la Fipresci décernèrent quant à eux leur « Prix de la Critique Internationale » au vétéran italien Gianni Amelio pour Le Premier Homme et à Axel Petersen pour Avalon.
Quant aux professionnels, ils se bousculèrent lors des projections qui leur étaient réservés, même si la crise sembla initialement ralentir les flux d’achat. Mais vendeurs et acheteurs étaient bien tous là, ou presque, comme à Berlin ou à Cannes, comme on a notamment pu le vérifier lors des très courues réception d’Unifrance ou de « European Film Promotion », l’organisme de promotion du cinéma européen – qui avait à nouveau organisé son initiative d’aide aux coproductions entre l’Europe et le Canada, « Producers Lab Toronto« . Le cinéma mondial était bien présent dans la « Rue Royale » (King Street) de Toronto en septembre!
Philippe J. Maarek
